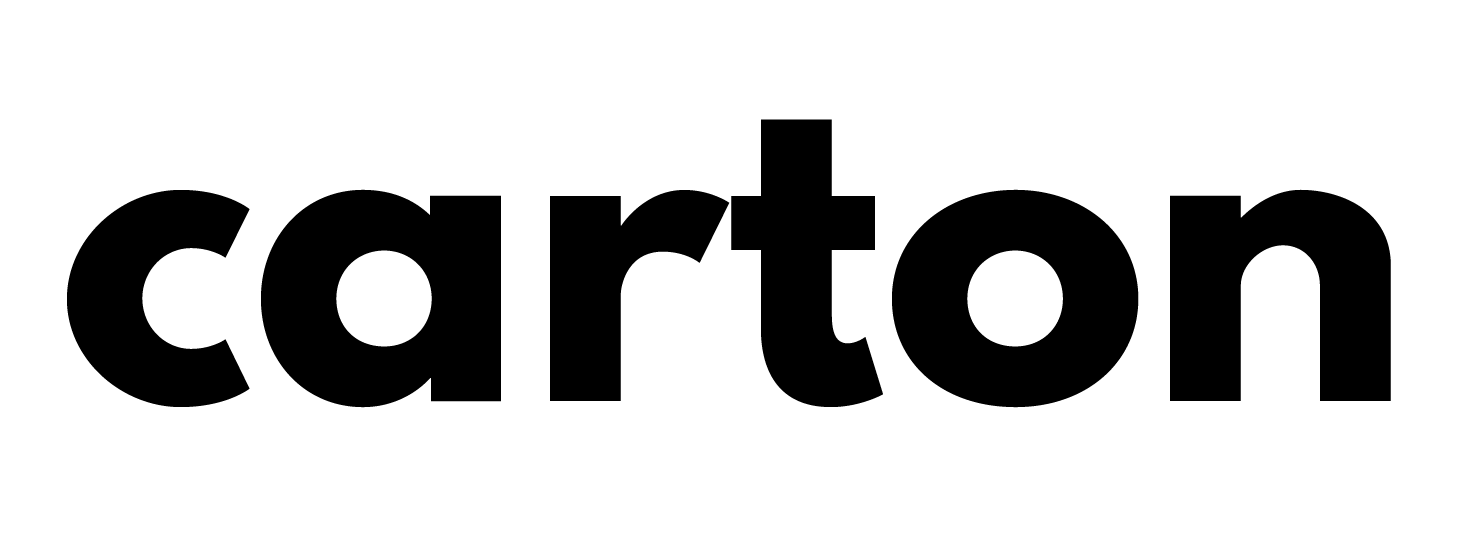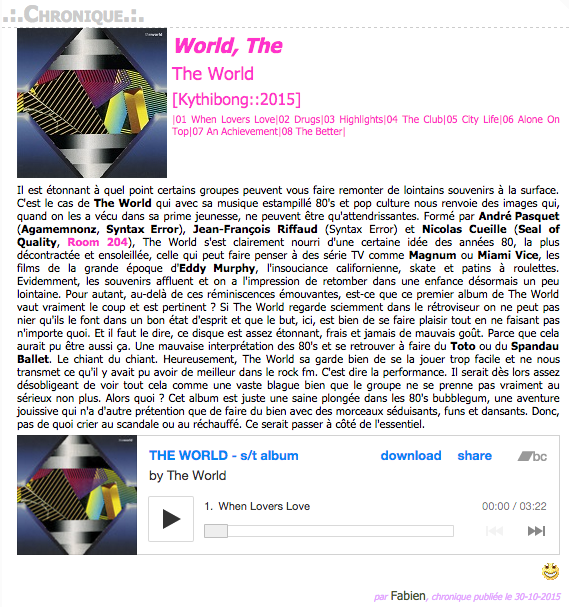Questo trio francese si esprime con un’attitudine vintage, radicata negli anni ’80. Stilisticamente variegati e difficilmente decifrabili, si muovono liberamente prendendo ispirazioni soprattutto dal sound e dalle ambientazioni electro-funk di una trentina d’anni fa. Molto vicini a gruppi come INXS e Talking Heads il trio si dilunga spesso in lunghe suite strumentali, eccedendo a volte in svisate prog o nel pop più becero di quel triste decennio. Tuttavia, in brani come “Drugs” dove il funky bianco domina e negli strani incroci tra l’hard-blues ed il pop di “When loves love”, il trio si esprime al meglio. Purtroppo, anche nei testi il trio ricorre i miti più perversi degli anni ’80, vale a dire quelli del successo a tutti i costi e quindi di quella figura antropologica che fu il prodotto della ‘Milano da bere/pere”, allora nuova, che erano gli yuppie.
Grosse journée pour Nicolas Cueille, qu’on retrouve tout seul derrière la six-corde, le micro et les machines de Seal Of Quality. Officiant depuis quelques temps également dans Room 204, celui-ci participe donc au split partagé avec Pneu qui sort ce même 16 octobre, toujours sur ce même label nantais (chronique ici). C’est également le rouennais qu’on retrouve ici à la manœuvre, s’adjoignant les services, notamment, d’un compatriote normand échappé desAgamemnonz. Etant donné le background chiptune et surf old school de ces deux protagonistes, ainsi que la propension du label à ne jamais fixer de limites de genre à ses sorties, il n’était guère aisé de deviner la direction qu’allait prendre ce petit LP. Bon en vrai, on pouvait quand même un peu le deviner, puisque le trio guitare/synthé/batterie a déjà sorti une démo l’an passé, dont certains titres figurent d’ailleurs sur ce disque. Il s’est donc attelé ici à en expurger les moins kitchs (je garde cependant l’espoir de pouvoir entendre à nouveau « Schizophrenia » et « Maximum Overdrive »), à réenregistrer le reste avec une prod’ encore plus vintage, et à leur adjoindre cinq nouveaux morceaux dans cette veine délicieusement régressive. The World nous ramène à l’âge d’or du soft rock, et s’écoute sur un transistor à piles en jouant au flipper, un verre de Tang finissant d’infuser sur une table en formica surplombant une banquette en skaï. Et si cette scène empreinte d’un modernisme désuet semble bien française, elle n’en reste pas moins symbolique d’une génération à la remorque d’un american way-of-life à peine plus visionnaire, inondée de hits mi-électriques mi-synthétiques importés d’Outre-Atlantique. The World, loin de courir après quoi que ce soit, digère ici après trente ans toutes ces influences mainstream pour finalement ne pas laisser grand chose dans les chiottes chimiques du mauvais goût. Quitte à rejouer la VHS, autant ne rien zapper. Les rouennais, tout en restant à bonne distance de la médiocrité pour faire preuve d’une efficacité tubesque, passent près d’une décennie d’hymnes radiophoniques, de slows de discothèques et de rock cathodique en revue, et nous transportent au coeur d’une pop culture qui partage son temps entre le cinéma de plein air, le café et sa borne d’arcade, le dancefloor à néons et la télé du salon. Les références sont innombrables et se révèlent par bribes à mesure que les titres défilent, de Ghostbusters pour « When Lovers Love » à INXS pour « Drugs » en passant par Nena pour « Highlights » ou The Bangles pour « The Club ». The World se révèle donc aussi imparable en instrumental que lorsque les voix font entendre leur soif de win, et se montre capable d’embuer les vitres du studio à coups de slows torrides (« Alone On The Top », « The Club »), d’animer l’aérobic matinal (« An Achievement », « City Life ») ou d’annoncer le début de la série familiale lambda (« The Better », « Highlights »). A peine regrettera-t-on quelques lignes de basse slappées qui brillent par leur absence, et une caisse claire qui pourrait faire encore plus « pschhh ». A l’origine d’un disque où chaque morceau se révèle être un hit, The World, sans qu’on sache bien s’il s’agit d’un hommage ou d’un pastiche (mais dans le fond, on s’en fout un peu), va au bout de ses principes pour jouer la carte du kitch ultime assumé, tout en faisant preuve d’une finesse d’écriture qui ne doit certainement rien à la paresse, et de facilités techniques qui se révèlent de façon encore plus flagrante en live. S/T de The World, c’est si tu n’as rien contre : Phil Collins, George Michael, INXS.
Hommes des années 80 jusqu’au bout des mains, ces Rouennais exhument avec leur premier album tout un pan de sous-culture qu’on croyait enseveli sous deux décennies de bon goût : des chansons à la hauteur du générique de sitcoms américaines, des synthés ras la gueule sur la plage arrière, les coudières cousues mains sur les vestes en jean à l’effigie de Van Halen. En toute modestie, ces enfants du tube cathodique ont choisi de s’appeler The World pour chanter un monde aux cristaux liquidés. A l’écoute du disque éponyme de The World, pas facile à repérer lors de vos prochaines requêtes Google, on se dit que l’anniversaire deRetour vers le futur, qui fête aujourd’hui ses 30 ans avec ses acteurs tantôt à cheveux blancs (Christopher Lloyd) tantôt tremblotant (Michael J. Fox) est tout sauf anodin. Evidemment le rock n’a pas la tronche qu’on espérait ; le Hoverboard est encore à l’état de prototype et la seule chose qui plane est encore cette impression de rendez-vous raté avec la modernité, et qu’on devine amer en regardant les photos promos des groupes d’époque. Rock smarties De ce retour vers les tutur’ pour faire joujou avec les traintrains à papa, le trio signé chez Kythibong a conservé les sonorités en éliminant tous les excès (drogues, ego, costumes à épaulettes) en rognant jusqu’à l’os la posture de héros MTV qu’on aura adorés ou haïs, selon qu’on était gamin ou adolescent fan de The Smiths. Restent les chansons, bien moins putassières que celles de Jamaica, qui restent en tête au point que certaines comme Drugsdonnent envie de s’enquiller un gym tonic après avoir fait son footing de golden boy en lisant les mémoires de Bernard Tapie. Réussir sa vie, se taper des gonzesses backstage après s’être taillé un rail de coke de la longueur de la bite à Rocco, aligner des solos à côté desquels ceux de Weather Report passeraient pour du Tchaïkovski ; tel est l’objectif de The World et de leur rock smarties avec double ration de supplément crème ; écœurant pour les fines bouches mais salutaire pour ceux fatigués des postures miséricordieuses de toute une partie de la génération des rockeurs traumatisée par Radiohead. Il y a évidemment sur cet album de quoi retapisser trois fois la chambre d’un ado ; c’est codifié à mort, révisionniste à blinde ; ça n’a pas la prétention d’être déniché par un digger à gants blancs en 2050 mais ‘’The World’’ est exécuté avec une telle sincérité (on peut même déguster un pain laissé au montage à 02’00 sur le bien nommé Highlights) qu’il en devient difficile de ne pas siffler ses mélodies au réveil comme si l’on était le Leonard di Caprio conquérant se vidant la vessie à l’avant d’un Titanic 8-bits. Devenir les rois du monde, les membres de The World ne le seront évidemment jamais, ce qui n’empêche pas d’espérer un futur moins déprimant qu’un nouvel album de Louise Attaque. La preuve : Nike vient tout juste d’annoncer la commercialisation des baskets auto-laçante portées par Marty McFly en 1985. Le futur ? Un éternel retour.
Avec un nom aussi vaste, on pourrait s’attendre à ce que la musique de ce trio soit englobante ou bien qu’elle nous rappelle les sonorités exotiques d’un voyage oublié. Mais non, The World emprunte ses timbres et son vocabulaire aux années 80... C’est donc à grand renfort de synthés cheap, d’une batterie plate et de voix claires que le trio nous ramène à nos vestes trop grandes à épaulettes, aux joggings multicolores, aux coupes de cheveux embarrassantes qui épousent la nuque, à nos rêves naïfs de skates volants... Il n’y a rien de nouveau dans cet album qui, jusqu’à l’esthétique de la pochette, cherche à nous tromper : s’agit-il d’une vieillerie trouvée dans un bac d’invendus chez Noz ? Non, il s’agit bien d’une nouveauté. Et c’est cet effort minutieux, à la fois comique et très sérieux, pour paraître anachronique, qui fait tout le charme de ce projet. Le pastiche pourrait certes sembler vain si ces musiciens n’avaient pas ce sens aigu de la mélodie, du refrain qui fait mouche, du riff évident et du rythme entraînant. André Pasquet et Jean-François Riffaud, déjà techniciens du décalage au sein de Syntax Error, ainsi que Nicolas Cueille, prince du 8-beats dans son projet Seal of Quality, et nouvelle recrue de Room 204, se distinguent nettement par leur volonté de ne suivre aucun mouvement actuel, aucune mode et pour faire du mauvais goût un appui pour exprimer leur propre personnalité.