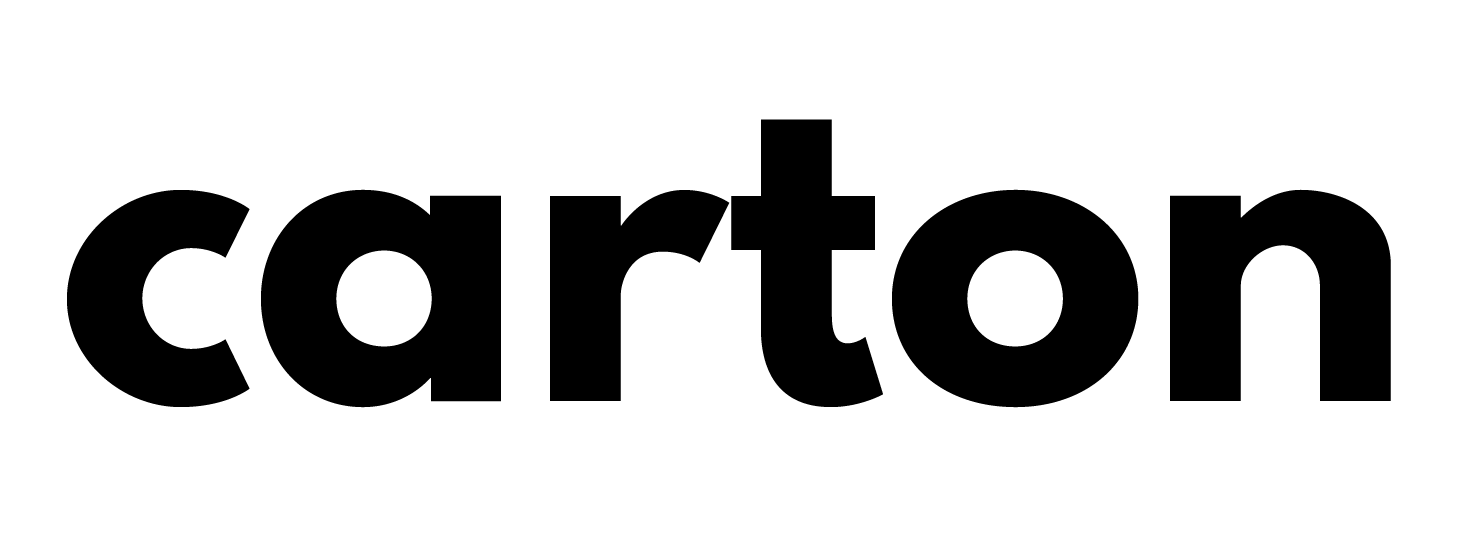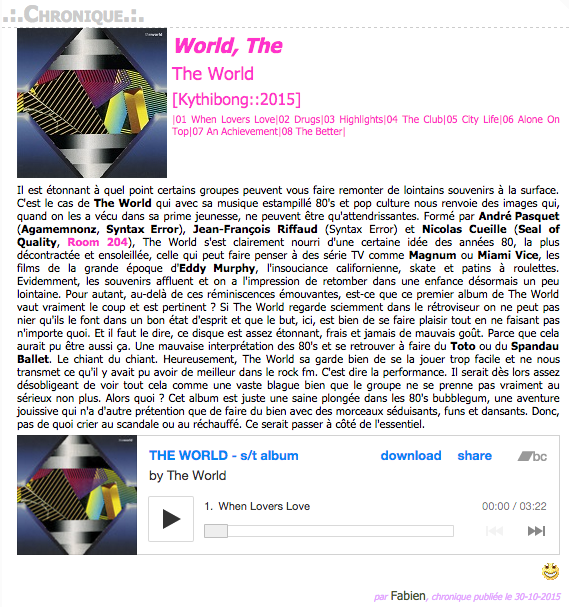Grosse journée pour Nicolas Cueille, qu’on retrouve tout seul derrière la six-corde, le micro et les machines de Seal Of Quality. Officiant depuis quelques temps également dans Room 204, celui-ci participe donc au split partagé avec Pneu qui sort ce même 16 octobre, toujours sur ce même label nantais (chronique ici). C’est également le rouennais qu’on retrouve ici à la manœuvre, s’adjoignant les services, notamment, d’un compatriote normand échappé desAgamemnonz. Etant donné le background chiptune et surf old school de ces deux protagonistes, ainsi que la propension du label à ne jamais fixer de limites de genre à ses sorties, il n’était guère aisé de deviner la direction qu’allait prendre ce petit LP. Bon en vrai, on pouvait quand même un peu le deviner, puisque le trio guitare/synthé/batterie a déjà sorti une démo l’an passé, dont certains titres figurent d’ailleurs sur ce disque. Il s’est donc attelé ici à en expurger les moins kitchs (je garde cependant l’espoir de pouvoir entendre à nouveau « Schizophrenia » et « Maximum Overdrive »), à réenregistrer le reste avec une prod’ encore plus vintage, et à leur adjoindre cinq nouveaux morceaux dans cette veine délicieusement régressive. The World nous ramène à l’âge d’or du soft rock, et s’écoute sur un transistor à piles en jouant au flipper, un verre de Tang finissant d’infuser sur une table en formica surplombant une banquette en skaï. Et si cette scène empreinte d’un modernisme désuet semble bien française, elle n’en reste pas moins symbolique d’une génération à la remorque d’un american way-of-life à peine plus visionnaire, inondée de hits mi-électriques mi-synthétiques importés d’Outre-Atlantique. The World, loin de courir après quoi que ce soit, digère ici après trente ans toutes ces influences mainstream pour finalement ne pas laisser grand chose dans les chiottes chimiques du mauvais goût. Quitte à rejouer la VHS, autant ne rien zapper. Les rouennais, tout en restant à bonne distance de la médiocrité pour faire preuve d’une efficacité tubesque, passent près d’une décennie d’hymnes radiophoniques, de slows de discothèques et de rock cathodique en revue, et nous transportent au coeur d’une pop culture qui partage son temps entre le cinéma de plein air, le café et sa borne d’arcade, le dancefloor à néons et la télé du salon. Les références sont innombrables et se révèlent par bribes à mesure que les titres défilent, de Ghostbusters pour « When Lovers Love » à INXS pour « Drugs » en passant par Nena pour « Highlights » ou The Bangles pour « The Club ». The World se révèle donc aussi imparable en instrumental que lorsque les voix font entendre leur soif de win, et se montre capable d’embuer les vitres du studio à coups de slows torrides (« Alone On The Top », « The Club »), d’animer l’aérobic matinal (« An Achievement », « City Life ») ou d’annoncer le début de la série familiale lambda (« The Better », « Highlights »). A peine regrettera-t-on quelques lignes de basse slappées qui brillent par leur absence, et une caisse claire qui pourrait faire encore plus « pschhh ». A l’origine d’un disque où chaque morceau se révèle être un hit, The World, sans qu’on sache bien s’il s’agit d’un hommage ou d’un pastiche (mais dans le fond, on s’en fout un peu), va au bout de ses principes pour jouer la carte du kitch ultime assumé, tout en faisant preuve d’une finesse d’écriture qui ne doit certainement rien à la paresse, et de facilités techniques qui se révèlent de façon encore plus flagrante en live. S/T de The World, c’est si tu n’as rien contre : Phil Collins, George Michael, INXS.
Hommes des années 80 jusqu’au bout des mains, ces Rouennais exhument avec leur premier album tout un pan de sous-culture qu’on croyait enseveli sous deux décennies de bon goût : des chansons à la hauteur du générique de sitcoms américaines, des synthés ras la gueule sur la plage arrière, les coudières cousues mains sur les vestes en jean à l’effigie de Van Halen. En toute modestie, ces enfants du tube cathodique ont choisi de s’appeler The World pour chanter un monde aux cristaux liquidés. A l’écoute du disque éponyme de The World, pas facile à repérer lors de vos prochaines requêtes Google, on se dit que l’anniversaire deRetour vers le futur, qui fête aujourd’hui ses 30 ans avec ses acteurs tantôt à cheveux blancs (Christopher Lloyd) tantôt tremblotant (Michael J. Fox) est tout sauf anodin. Evidemment le rock n’a pas la tronche qu’on espérait ; le Hoverboard est encore à l’état de prototype et la seule chose qui plane est encore cette impression de rendez-vous raté avec la modernité, et qu’on devine amer en regardant les photos promos des groupes d’époque. Rock smarties De ce retour vers les tutur’ pour faire joujou avec les traintrains à papa, le trio signé chez Kythibong a conservé les sonorités en éliminant tous les excès (drogues, ego, costumes à épaulettes) en rognant jusqu’à l’os la posture de héros MTV qu’on aura adorés ou haïs, selon qu’on était gamin ou adolescent fan de The Smiths. Restent les chansons, bien moins putassières que celles de Jamaica, qui restent en tête au point que certaines comme Drugsdonnent envie de s’enquiller un gym tonic après avoir fait son footing de golden boy en lisant les mémoires de Bernard Tapie. Réussir sa vie, se taper des gonzesses backstage après s’être taillé un rail de coke de la longueur de la bite à Rocco, aligner des solos à côté desquels ceux de Weather Report passeraient pour du Tchaïkovski ; tel est l’objectif de The World et de leur rock smarties avec double ration de supplément crème ; écœurant pour les fines bouches mais salutaire pour ceux fatigués des postures miséricordieuses de toute une partie de la génération des rockeurs traumatisée par Radiohead. Il y a évidemment sur cet album de quoi retapisser trois fois la chambre d’un ado ; c’est codifié à mort, révisionniste à blinde ; ça n’a pas la prétention d’être déniché par un digger à gants blancs en 2050 mais ‘’The World’’ est exécuté avec une telle sincérité (on peut même déguster un pain laissé au montage à 02’00 sur le bien nommé Highlights) qu’il en devient difficile de ne pas siffler ses mélodies au réveil comme si l’on était le Leonard di Caprio conquérant se vidant la vessie à l’avant d’un Titanic 8-bits. Devenir les rois du monde, les membres de The World ne le seront évidemment jamais, ce qui n’empêche pas d’espérer un futur moins déprimant qu’un nouvel album de Louise Attaque. La preuve : Nike vient tout juste d’annoncer la commercialisation des baskets auto-laçante portées par Marty McFly en 1985. Le futur ? Un éternel retour.
Alors que L’Humanist SK Festival bat son plein entre Lyon et Paris (Event FB), le label plus Lyonnais que Bocuse S.K Records vient de révéler le 21 septembre dernier l’un des secrets les mieux gardés de la capitale des Gones avec la parution du premier EP de La Société Étrange. A la base duo né d’une attirance commune surnaturelle entre Antoine Bellini et Romain Hervault, avec en toile de fond un amas d’instruments analogiques et des résonances de musiques industrielles, krautrock et early electronic, cette toute nouvelle formation, pour laquelle François Virot a enregistré et mixé Au Revoir conçu à quatre mains, s’est récemment étoffée d’un percussionniste en la personne de Jonathan Grandcollot. A l’écoute de leurs divagations aussi minimalistes qu’habitées, et dans les interstices desquelles il n’est pas rare de rencontrer un Genesis P-Orridge, un Chris Carter ou même un Holger Czukay, on se prend vite à croire en leur bonne étoile, ressuscitant sans en profaner l’essence ces nébuleuses virées instrumentales ayant fait danser les enfants de l’Occident sur les cendres encore fumantes de la guerre puis de la désindustrialisation. Au Revoir se déflore ci-après en intégralité quand bien même La Societé Etrange sera en concert le temps d’une mini-tournée avec Clara Clara et Deux boules Vanille du 1er au 3 octobre.
La Societé Etrange sera en concert le temps d’une mini-tournée avec Clara Clara – qui en profitera pour présenter son tout nouvel album – et Deux boules Vanille qui débute dès ce soir à Genève et qui se termine samedi à l’Espace B parisien. Si tu aimes les Lyonnais et que tu t’en carre de JMA, on t’offre deux places. Pour tenter ta chance, rien de plus simple : envoie tes nom, prénom et un mot d’amour à l’adresse hartzine.concours@gmail.com ou remplis le formulaire ci-dessous. Les gagnants seront prévenus la veille du concert.
Une de plus qui se termine, allez. 2015, à celle où j'écris ces mots, finit dans quelques heures. "Au Revoir", oui. Ne nous étendons pas… À ce moment précis, ce disque-là, sorti celle-ci, émane entre mes murs, avec les parfums de cuissons, les fragrances, les couleurs, la lumière – je baisse l’intensité de l'allogène, voilà ; je monte le son ; prêt à partir, bientôt, pour aller l’achever ailleurs, l'an. Je me souviens deux autres soirs, parmi ces trois cent-soixante cinq bientôt révolus. Ils y étaient, eux – La Société Étrange. Les deux fois, je crois, j’avais à peine parcouru le programme, les noms sur les flyers. La première des deux, j’en suis sûr, j’avais oublié que c’étaient ces trois là, sous celui-ci. À coup sûr, l’une et l’autre, ça m’a saisi. Le relâchement soudain, le sourire aux oreilles ; l’envie de crier, la deuxième, avec l’inconnue juchée sur le caisson de basses, qui roulait du corps à côté d’une autre au prénom pas commun : "La Sociétééééé". Elle faisait des signes curieux avec ses mains. Je crois que je roulais aussi… La Société Étrange – est-ce un pléonasme, ce nom, ou bien autre chose, ou bien un oxymore ? – fait rouler du boule. Les femmes belles, les hommes laids, inversement, toutes variantes et variables et transformations imaginables ; et puis dans-l'œil-qui-regarde, etc. ; on n’y vient pas tous avec la même chose dans le crâne, le ventre, le cornet, ce qu’on voudra ; on ne se lasse pas de se voir tous si diversement constitués, foutus, mis, mus. Dans ces endroits-ci, il y a des Gros, des Osseux, des Ivres et des Qui Tournent à L’Eau (bon… sans doute assez peu), toutes sortes d’allumés, un peu, d’autres qui viennent, peut-être, pour échapper un peu à l’extinction – des feux, tout court, d’un truc qui les regarde. C’est ouvert. Je me souviens d’un type, une des deux nuits, que je n’avais jamais vu là et plus jamais croisé, ensuite, qui avait l’air de trouver fou d’avoir envie de s’asseoir, juste en face d’un ampli, relaxé apparemment comme il ne savait pas qu’on peut. On avait dit "eh ben vas-y", en le laissant passer. On avait continué, nous-quelques-uns-toujours-collés-devant, à remuer, faire l’onde, en embrasser la courbure, les renflements, le remous. Cette basse pèse, ancre, en même temps – décidément – fait roulement. Épaisse et pointillée, ligne pulsée. Surface oscillante. Le batteur couvre ses toms mais joue debout. Il coure, d’un élément à l’autre. La battue soudain lévite. Les machines du troisième vrillent un espace, exsude son volume, sa résonance. Pour moi – et pas seulement pour ces circonstances où je l’ai découverte ; pas uniquement pour l’heure tombante où j’écris ces lignes – c’est une musique nocturne. Vaste, opaque mais parcourue de luisances, profondeur, dehors habité. Ce nom leur va bien : ils jouent les places d’une civilisation rêvée, pressentie, encore poursuivie, peut-être. Peuplées non pas de cohortes anesthésiées, venues là pour oublier ; mais quand ils s’y mettent, où ceux qui écoutent se trouvent dans ce moment-là, vraiment, l’attention stimulée. Le mouvement qui touche au corps, tout de suite et longuement, mais sans court-circuiter la tête, l’organe cérébral, où ça circule de plus belle. Une sorte d’état rare, calme vif, excitation lucide et sans soubresaut, sans peur des redescentes. Ces six plages – et les dérives et variations qu’ils donnent en direct, donc, en concert – tiendraient d’une sorte de dub, si l’on veut ; mais "versions", alors, dont les "originales" n’existeraient pas, seraient perdues, seraient le secret véritable ; les transformations, plutôt, jouées tout de suite, telles quelles, visées autant que réminiscences, idées prises à ce point-là d’elles-mêmes. D’autres, en parlant, évoquent les mutations des musiques industrielles… Pourquoi pas. Mais on se défera l’esprit, alors, de tout l’appareil théorique, du souci "d’anti-musique" ou autre explications. On pourrait très bien dire simplement "électro", allez, si l’on croit ce qui nous prend encore aux centres de gravité, même "techno", comme on le sent, puisque c’est fait pour ça, ces formes qui bougent. Ou bien – au hasard ; si c’est ce qu’on a dans l’oreille – calypso, steelband passée dans les circuits imprimés, avec même les criquets de la lagune, comme il m’amuse d’entendre, à cet instant, sur Première Valise. On inventera le nom adéquat. Ou bien on se contentera – au sens le plus plein, le plus réjoui du terme – de son absence permanente ou momentanée. Les machines sont des instruments comme les autres. C’est à dire des prolongements, des possibles incarnés dans des choses qui ne vivent que quand on les touche, quand on les met sous tension. Ceux de La Société Étrange ont trouvées celles là – basse et batterie, donc, et appareils à touches, potentiomètres, pads. Des organes de plus, des objets qu’ils se greffent. Ils en font des agencements, singuliers, familiers. C’est heureux qu’ils tournent beaucoup, par là ou plus loin. Je vous souhaite de les croiser. J’espère que ce disque vous en filera l’envie – et qu’après, avant, au bon moment, vous y prendrez ce plaisir du flottement pas engourdi, de l’emballement tranquille. Pour le moment, je vous laisse… Une autre fête m’attend, une autre compagnie. Le changement de chiffre, sur le cadran, ne sera guère plus que le prétexte. C’est une manière, encore, de toujours continuer.
Avec un nom aussi vaste, on pourrait s’attendre à ce que la musique de ce trio soit englobante ou bien qu’elle nous rappelle les sonorités exotiques d’un voyage oublié. Mais non, The World emprunte ses timbres et son vocabulaire aux années 80... C’est donc à grand renfort de synthés cheap, d’une batterie plate et de voix claires que le trio nous ramène à nos vestes trop grandes à épaulettes, aux joggings multicolores, aux coupes de cheveux embarrassantes qui épousent la nuque, à nos rêves naïfs de skates volants... Il n’y a rien de nouveau dans cet album qui, jusqu’à l’esthétique de la pochette, cherche à nous tromper : s’agit-il d’une vieillerie trouvée dans un bac d’invendus chez Noz ? Non, il s’agit bien d’une nouveauté. Et c’est cet effort minutieux, à la fois comique et très sérieux, pour paraître anachronique, qui fait tout le charme de ce projet. Le pastiche pourrait certes sembler vain si ces musiciens n’avaient pas ce sens aigu de la mélodie, du refrain qui fait mouche, du riff évident et du rythme entraînant. André Pasquet et Jean-François Riffaud, déjà techniciens du décalage au sein de Syntax Error, ainsi que Nicolas Cueille, prince du 8-beats dans son projet Seal of Quality, et nouvelle recrue de Room 204, se distinguent nettement par leur volonté de ne suivre aucun mouvement actuel, aucune mode et pour faire du mauvais goût un appui pour exprimer leur propre personnalité.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, Hippie Diktat n’est pas le titre du dernier éditorial de Valeurs Actuelles au sujet des vélos en libre service ou de l’invasion de nos villes par les supérettes bio. Certes, on pourrait filer la métaphore en rapprochant la dureté acrimonieuse du saxophone baryton d’Antoine Viard, aperçu dans le quartet Pipeline, du ton bilieux de la guitare de Richard Comte avec les plumes de l’hebdomadaire, mais la comparaison s’arrêterait là ; il y a fort à parier que cette musique improvisée hérissée de métal ne sera jamais la bande-son des bouclages du magazine.
Sorti en coproduction entre le label Coax et les nouveaux venus de BeCoq Records, Black Peplum est le premier album d’un power trio qui a su se faire une place au cœur de cette scène en pleine effervescence, qui aime à marier la virulence du hardcore et l’immédiateté de l’improvisation. La sixième production de BeCoq confirme sa tendance à se situer au confluent des marges, là où se croisent le free, la noise et, donc, le hardcore, trois étiquettes que Hippie Diktat peut faire revendiquer. Une réputation précède le trio, ponctuée, voire assenée, dès « Black Peplum » par le batteur Julien Chamla, par ailleurs membre du quartet We are All Americans de Hasse Poulsen : celle d’un groupe cogneur et sans compromission. Elle se voit confirmer par la densité de l’album, où le baryton de Viard vient doubler la guitare sur la crête des cymbales.
Dans le maelström de « Deaf Can Dance », les hurlements de ce baryton peuvent faire songer à Eric Vagnon (Spoo), comme la sécheresse de la guitare trouve une proximité naturelle avec Kouma, autre trio du collectif Coax. Mais passée la décharge d’électricité, on découvre une certaine finesse derrière le mur de son, une masse extrêmement ouvragée malgré son aspect brut. C’est dans « Angoisse » que tout ceci se révèle, à mesure que l’impression de bruit blanc de la saturation se prolonge dans une sorte de continuum lancinant et mystérieux. Comme le paon aux centaines d’yeux qui orne sa pochette, Hippie Diktat sait transformer ses rodomontades agressives en parade colorée. Prenez garde tout de même aux coups de bec…
HIPPIE DIKTAT / Black Peplum (BeCoq/Coax)
Ce disque est une collaboration entre deux jeunes étiquettes françaises qui me font flipper fort. Hippie Diktat est un power trio saxo baryton/guitare/batterie qui mélange skronk, rock psychédélique et doom. L’album est court (31 minutes) mais puissant à l’os et très convaincant. Ça me fait penser à Guapo, à Kruzenshtern i Parohod et à Seven That Spells, tout en même temps. Antoine Viard est monstrueux au saxo. Recommandé.
This record is a collaboration between two young French labels that regularly get me all excited. Hippie Diktat is a power trio with baritone sax, guitar and drums. They blend skronk, psychedelic rock, and doom. Their album is short (31 minutes) but it packs a serious, convincing punch. I’m thinking of Guapo, Kruzenshtern i Parohod, and Seven That Spells all rolled into one. Antoine Viard is a monster on baritone sax. Recommended.
Hippie Diktat
Black Peplum – CD
Coax records / BeCoq records 2014
Ah putain, comme ça a été dur pour m’en remettre. Mais alors là vraiment. Je ne parle pas de mes vacances d’été prolongées, sous le soleil caniculaire du Jura – et donc de mon absence totale de volonté pour reprendre l’écriture de chroniques de disques que personne ne lit – mais de ce concert, il y a un peu plus d’une année, où je découvrais enfin ce groupe précédé d’une réputation plutôt flatteuse : Hippie Diktat. Ne vous fiez surtout pas à ce nom, parce qu’Hippie Diktat n’est pas du genre à jouer une musique compatible avec les cours de sophrologie de votre maman ou les omelettes aux champignons hallucinogènes que votre papa se plait à cuisiner à chaque automne. Pas plus que l’oiseau ornant la pochette de ce disque ne donnera une indication fiable quant au réel contenu de Black Peplum, nouvel album de Hippie Diktat. Car comme l’affirmait ce cher Guillaume (Apollinaire), il n’existe peut-être pas d’animal plus ridicule et plus décevant que le paon : « En faisant la roue, cet oiseau / Dont le pennage traîne à terre / Apparaît encore plus beau / Mais se découvre le derrière. » Bon, rassurez-vous : je vais tout de suite arrêter de faire le malin et je ne vais pas vous causer poésie tout du long, parce que ce groupe mérite bien mieux que d’être comparé à un volatile orgueilleux.
Hippie Diktat est donc un trio. Un trio avec un saxophoniste qui pratique le baryton trapu, un guitariste sculpteur de saturation et un batteur opiniâtre. Et Hippie Diktat joue fort. Hippie Diktat joue gras. Hippie Diktat joue épais. Hippie Diktat est expert dans l’art de transmuter le jazz cher aux hippies et aux intellos de gauche pour le recomposer en quelque chose qui ne ressemble pas à une grosse merde progressive ou à une suite d’épanchements virtuoses. Et s’il y a du jazz ici, il n’est pas réellement free non plus, servant avant tout de référentiel mélodique voire lyrique – les complaintes du saxophone sur Full HD me donnent sans cesse la chair de poule – pour mieux préparer le déluge de feu qui pointe juste derrière et va bientôt nous exploser à la gueule. Plus organique et plus adipeux (qui a dit metal ?) que leurs collègues de Kouma, les trois garçons de Hippie Diktat partagent cependant avec les lyonnais ce volontarisme décomplexé et visionnaire qui, à nouveau, démontre infailliblement que l’on peut être un musicien qui a été à l’école et aimer quand même et malgré tout faire du bruit signifiant, tout ça sans passer pour un poseur ou un prétentieux (que les baba-zoukeurs fans de happy-math-noise lèvent la main et quittent la salle immédiatement).
Deuxième album de Hippie Diktat, Black Peplum est ainsi largement plus à la hauteur de ce concert d’il y a un an, reléguant au rang de souvenir un premier disque autoproduit méritant mais encore trop imprégné du jazz à papa, certes plein de bonnes idées mais à la personnalité pas encore suffisamment affirmée. Là on sent bien que le groupe est sur la bonne voie, qu’il a trouvé quelque chose et qu’avec Black Peplum il est habité par une énorme envie d’en découdre et de nous surprendre. Me vient immédiatement à l’esprit cet autre extrait (mon préféré à dire vrai) du Bestiaire de Guillaume Apollinaire et qui à mon sens colle bien mieux à la vindicte rageuse, intransigeante, électrique et parfois inquiétante de Hippie Diktat, cela s’appelle Le Poulpe : « Jetant son encre vers les cieux / Suçant le sang de ce qu’il aime / Et le trouvant délicieux / Ce monstre inhumain, c’est moi-même. » Merde, j’ai encore trouvé le moyen de parler poésie, quel sale intello je fais.
Hazam (10/09/2014)
Par contre ça va nettement moins rigoler avec HIPPIE DIKTAT (oui, c’est soirée spéciale noms de groupes à la con). Un trio dans lequel on retrouve le guitariste Richard Comte, auteur d’un album solo dont on reparlera très bientôt et déjà vu en concert avec Heretic Chaos, duo qu’il formait avec Yann Joussein de DDJ, SnAP, etc… Est-ce-que tout le monde arrive à suivre ? Non ? Bon, Hippie Diktat est, après SnAP découvert le jour d’avant, un autre groupe du collectif Coax, coopérative musicale décidemment en pleine ébullition. Au côté du guitariste jouent également un saxophoniste baryton (Antoine Viard) et un batteur (Julien Chamla).
Quoi ? Vous vous en foutez un peu beaucoup des noms de ces trois musiciens ? Et bien vous avez tord. Parce que personnellement je vais faire un effort tout de suite là et maintenant pour dénicher et écouter tout les groupes et projets auxquels ces trois types participent par ailleurs. Je vais peut-être être déçu mais j’ai confiance. Tout ça parce que Hippie Diktat a été une claque énorme en concert. Un mélange de noise-rock et de freeture d’une puissance incroyable et surtout d’une ampleur volumétrique qui vous écrase à chaque instant. Lorsque le groupe ralentit la cadence le phénomène d’écrasement est encore plus palpable, oui on n’est pas loin d’un jazz metal en version sale et grésillante et dans ces moments là je perds un peu le contrôle de moi-même. OK, je ne suis pas le seul et Hippie Diktat – le meilleur groupe avec lequel Cheverny a joué durant sa tournée triomphale du printemps 2013, me dira-t-on un peu plus tard dans la soirée – électrise le public entassé au Périscope. Révélation.
Un bling, un groink et un tchak, il n’en faut pas plus à Hippie Diktat pour dessiner un agrégat jazz/metal/noise certes furieux mais d’une grande finesse. Après le chouette éponyme autoproduit de 2012, place à Black Peplum qui, comme son nom l’indique, voit le trio faire les choses en grand.
Ils sont trois mais sont capables de sonner comme quinze. Pourtant, l’ensemble reste paradoxalement très aéré. Réunion du saxophone baryton, touche-à-tout mais néanmoins plombé d’Antoine Viard (Pipeline, The A.A’s ou encore Tristanol, liste non exhaustive) acoquiné à la batterie finaude de Julien Chamla (We Are All Americans, Helved Rüm, Féline, MOBILE, INSEL MUSIK entre autres, sans oublier ses travaux solo), sous l’égide de la guitare enragée de Richard Comte (Heretic Chaos, un nombre impressionnant de collaborations mais aussi responsable d’un album solitaire, Innermap dont je ne saurais trop vous conseiller l’écoute), Hippie Diktat fait naître un sacré bordel à la sortie des enceintes. Le trio atomique dynamite son jazz déjà bien disloqué à grands coups de noise furibarde et balance des pincées de metal par-dessus pour rigidifier le tout. Et justement, force est de constater que le tout tient fièrement debout, bien campé sur ses fondations quoi qu’il arrive. « Hippie Diktat’s music is radical, raw and powerful » avance le trio, on ne saurait mieux dire. Nouvelle sortie du prolifique BeCoq après l’excellent Kindergarten de Louis Minus XVI, on tient là un disque qui est du même bois. Le même niveau d’excellence, la même expertise, les mêmes intentions sans doute aussi, que l’on pourrait parfaitement résumer par la laconique formule des Dead Neanderthals : « FUCK conventions and FUCK expectations ». En effet, la belle corolle de paon verte et bleue qui orne la pochette ne laisse en rien présager ce qu’elle cache. Un truc nucléaire qui balance de belles rasades retorses alternant avec des moments plus apaisés, très lents et rampants. Ils permettent au cortex de recouvrer son souffle quand le groupe empoigne l’auditeur partout ailleurs sans chichis en apposant simplement ses doigts autour de son cou. En relâchant ainsi son étreinte de temps en temps, la sidération ne s’effrite pas. Pourtant Black Peplum n’est pas foncièrement long mais s’il fallait recevoir ses déflagrations tout de go et sans pause, son intensité s’en trouverait forcément ternie. Et puis, loin d’être un groupe bas du front et sans nuances, Hippie Diktat préfère de toute façon privilégier l’exploration, le contre-pied et la rupture plutôt que se contenter de n’être que monochrome. Sans doute est-ce là aussi le sens de sa pochette multicolore à bien y regarder.
Cinq titres où la sauvagerie le dispute au silence, où le trio montre qu’il peut faire très mal mais aussi rentrer à l’intérieur de lui-même et se taire simplement. Quoi qu’il en soit, cette demi-heure passe bien trop vite et à peine les onze minutes et quelques du très impressionnant et bien nommé Angoisse viennent-elles d’agoniser que l’on sent poindre l’envie d’en entendre beaucoup plus. On se rabat donc sur le disque et on repart bien vite dans les circonvolutions plombées et urgentes de Black Peplum qui montre la batterie se reconfigurer sans cesse au gré des attaques de la guitare contre les lignes massives du saxophone. On a connu plus pacifique comme entame mais aussi moins saisissant. Et qu’Hippie Diktat balance ses tripes sans attendre dès le premier titre fait naître une furieuse envie d’explorer la suite. Ça tombe bien, E. Peacock voit le groupe tutoyer Noxagt ou Monno en densité sous l’effet d’une guitare proprement tellurique qui élabore un mur du son robuste que les coups de boutoir du baryton ont bien du mal à lézarder. Le climax est légèrement rompu sur un Deaf Can Dance durant lequel la guitare se tait pour laisser le saxophone et la batterie dialoguer tranquilles quelques instants. Sans doute le titre le plus rampant de Black Peplum. Le plus « jazz » aussi. Il reste cependant tout aussi accaparant que les autres. Full HD poursuit cette voie et montre à quel point le trio se fout des étiquettes. Quelques breaks typiquement metal l’ornementent (et cette fois-ci, c’est à Zu que l’on pense) que l’on retrouve très vite sur Angoisse. Le sommet. Disloqué, haché menu, doté d’une lourdeur extrême mais également très aéré, Hippie Diktat montre ici l’éventail de ses armes et se livre sans retenue. Les tympans en prennent plein la gueule mais pas que, le silence gagne du terrain peu à peu et finit par l’emporter. Un truc que l’on rêve de croiser en live pour voir comment le groupe restituera sa structure complexe et proprement métamorphe. Toutefois, on voit bien à quel point le trio s’accommode du studio, l’enregistrement de Richard Comte himself, tout à la fois naturel et détaillé, donne tout son poids à une mixture qui n’en manque déjà pas et lui permet d’habiter pleinement l’espace.
« Sale est son poil, généreux toujours... le hippie rit/Volontés atrophiées, vivre l’urgence... le hippie peste/Énergie décadente, masse sonore sauvage... le hippie chie/AMOUR » peut-on lire ici ou là et bien que Black Peplum mette en avant le côté hirsute de la formation, elle fait preuve par ailleurs d’une telle générosité, d’une telle débauche proprement offerte que même rigide et furibarde, elle n’en reste pas moins, c’est vrai, foncièrement hippie (enfin, en tout cas la version Flower Power qui ne s’était pas encore vendue au Grand Capital). Quoi qu’il en soit, voilà encore une sacrée perle à porter au crédit de Coax, de BeCoq et en règle générale d’une scène jazz/noise/metal/expérimentale locale et souvent triangulaire en pleine expansion (Louis Minus XVI, Kouma et tant d’autres). De la fureur, du bruit, de la tension et de l’apaisement, au final beaucoup de liberté et de souffle contenus dans des morceaux dynamiques qui empruntent ici et là pour construire un ailleurs saisissant.
Brillant.
Au rythme quasi-frénétique d’un EP par an, Ok dévoile depuis 2011 un répertoire folk concrétisé cette année par la sortie d’un premier album intitulé Shards. Sous ses airs de formation acoustique, le groupe puise ses influences dans le rock, qu’il soit hard ou pop, et dans l’électro. En résultent des compositions rythmiquement élaborées, appuyées par des sonorités synthétiques surprenantes pour ce registre, et renforcées par un jeu de guitare parfois déstructuré à la manière de Sonic Youth. L’ensemble, produit avec efficacité, dégage une impression de minimalisme chère aux White Stripes. Paradoxal par ses compositions, Ok l’est également par la voix de son chanteur ajoutant à Shardsune dimension lyrique. S’il n’est pas question d’opéra-rock inspiré de Queen, la bande gagne davantage en diversité tout en préservant un caractère folk américain. Loin de se disperser maladroitement dans divers registres, Ok développe un univers musical varié, original et accessible.
Faisant appel aux instincts primaires, “Shards”, le premier album de OK, est à la fois un voyage intérieur et une ouverture sur l’autre. « A Night To Switch On », aux mélodies pop, teintées de sonorités hindous, fait penser aux grands succès de David Bowie. Ambitieux, après deux EPs, sortis respectivement en 2011 et 2012, le groupe prend le pari de voir plus grand et de toucher un plus large public. « Shards » est introduit par une guitare électrique style rock 70’s, où l’ on sent leurs influences stoniennes. « Turning On A Dime », entre pop léchée et glam rock sur fond de banjo, rend l’auditeur nostalgique. OK sait surfer sur différents courants musicaux tout en sachant rester lui-même. « Road », à la guitare hachée et vibrante fait parfois penser aux intros d’Angus Young. Truffé de référence et de clin d’œil musicaux, OK réussit le pari fou avec « Shards » de réconcilier tous les amateurs de rock.